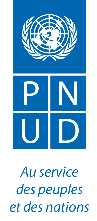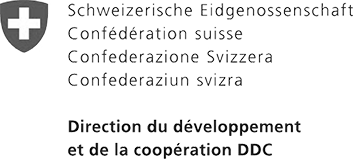Ils fuient la guerre, la persÃĐcution, la misÃĻre. Venus du Pakistan, de Somalie, de GuinÃĐe ou encore du Burundi, prÃĻs de 1 000 rÃĐfugiÃĐs et demandeurs dâasile vivent aujourdâhui à Madagascar. Un chiffre en hausse notable depuis la pÃĐriode post-Covid, selon les donnÃĐes du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les RÃĐfugiÃĐs (UNHCR). Mais dans un pays oÃđ leur existence reste largement invisible, comment ces ÃĒmes en quÊte de sÃĐcuritÃĐ survivent-elles au quotidien ? PlongÃĐe dans leur rÃĐalitÃĐ, loin des regards.
Ils vivent majoritairement dans les quartiers discrets dâAntananarivo, cherchant l'anonymat. C'est le cas de cette mÃĻre cÃĐlibataire, originaire de GuinÃĐe, arrivÃĐe sur la Grande Ãle il y a 17 ans avec son mari. Aujourd'hui seule avec ses quatre enfants, abandonnÃĐe par son ÃĐpoux, elle se bat sans aucun soutien formel, subsistant grÃĒce à un petit commerce informel. Son tÃĐmoignage est poignant.
ÂŦ Ce n'est pas facile d'Être rÃĐfugiÃĐe à Madagascar, je suis ici depuis 17 ans maintenant. Le problÃĻme est que, mÊme à l'hÃīpital, le prix pour les rÃĐfugiÃĐs et les ÃĐtrangers n'est pas le mÊme que pour les Malgaches. Si la consultation coÃŧte par exemple 5 000 Ar, c'est entre 7 500 et 10 000 Ar pour nous. Ma fille est en classe de seconde, on leur demande de faire des stages. Mais si elle se prÃĐsente dans une entreprise ou un hÃītel pour travailler ou faire un stage, on lui refuse, en disant qu'elle n'est pas Malgache et qu'elle n'en a pas le droit... Moi je pense que tous les Êtres humains sont ÃĐgaux, mais ici c'est le contraire... Je fais de petits commerces, c'est trÃĻs difficile pour moi de vivre, avec les enfants, Âŧ explique-t-elle.
La survie sans statut ni ressources
MÊme combat pour cet homme, originaire du Burundi, qui a fui la guerre en 2015. Aujourdâhui, il survit sans emploi ni papiers officiels valides. Son dÃĐsespoir est palpable. Selon lui, ÂŦ avec mon statut de rÃĐfugiÃĐ, j'ai vraiment frappÃĐ Ã beaucoup de portes ici, en vain. Avec mes papiers, ils n'acceptent pas. Je n'ai pas de passeport, ils demandent des casiers judiciaires, etc. Donc pas moyen de travailler. La vie est trÃĻs dure, je dÃĐpense beaucoup... je ne travaille pas, la santÃĐ aussi est un problÃĻme, on ne peut pas se la payer. Je suis vraiment trÃĻs fatiguÃĐ. Âŧ
Face à cette prÃĐcaritÃĐ, le CDA (Conseil de DÃĐveloppement dâAndohatapenaka), en partenariat avec lâUNHCR, prend en charge lâidentification et lâaccompagnement des rÃĐfugiÃĐs sur le territoire malgache. Onja Andriamilanto, responsable de la protection au niveau de l'UNHCR, explique le processus initial : ÂŦ Lorsquâils arrivent ici, nous les recevons pour un petit entretien, afin de comprendre ce qui les a poussÃĐs à fuir leur pays. Ensuite, ils sont enregistrÃĐs dans notre base de donnÃĐes et reçoivent un certificat â un document lÃĐgal qui remplace un passeport. Câest ce qui les distingue des migrants en situation irrÃĐguliÃĻre. Âŧ
MalgrÃĐ les actions menÃĐes par ces organisations, la population malgache reste malheureusement peu informÃĐe sur la situation de ces hommes, femmes et enfants qui ont tout laissÃĐ derriÃĻre eux, espÃĐrant trouver une vie digne à Madagascar.
Nour Nandrasana et Ravo Andriantsalama