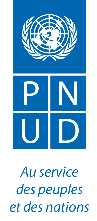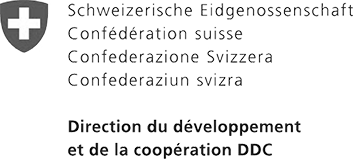Un hÃĐmicycle clairsemÃĐ, une atmosphÃĻre tendue et un constat accablant. La sÃĐance plÃĐniÃĻre consacrÃĐe au rapport sur les activitÃĐs de lutte contre la corruption 2024, ce mardi à lâAssemblÃĐe nationale Tsimbazaza, a mis en lumiÃĻre une vÃĐritÃĐ brutale : le systÃĻme malgache, bien qu'engagÃĐ, est en panne de moyens. Si la volontÃĐ d'afficher la lutte est là , lâefficacitÃĐ des institutions anti-corruption reste gravement entravÃĐe.
à 10h30, l'ouverture de la sÃĐance s'est faite en prÃĐsence de seulement huit dÃĐputÃĐs, avec la figure solitaire de Tinoka Roberto au perchoir, assurant la prÃĐsidence de la sÃĐance. Majoritairement issus de lâopposition, les rares parlementaires prÃĐsents ont pointÃĐ du doigt une situation alarmante, alimentÃĐe par une perte de confiance gÃĐnÃĐralisÃĐe. Siteny Randrianasoloniaiko, briÃĻvement aperçu, sâest ÃĐclipsÃĐ avant de revenir pour un plaidoyer virulent, tandis que le nombre de dÃĐputÃĐs a pÃĐniblement atteint la vingtaine au fil de la rÃĐunion.
Le prÃĐsident du ComitÃĐ pour la Sauvegarde de lâIntÃĐgritÃĐ (CSI), Jean Louis Andriamifidy, a dâemblÃĐe identifiÃĐ le problÃĻme central. Selon lui, ÂŦ le principal obstacle pour la Lutte contre la Corruption (LCC), ce sont les moyens. Notamment les moyens financiers. Le budget allouÃĐ Ã la LCC baisse dâannÃĐe en annÃĐe, comparÃĐ Ã celui de lâÃtat. Âŧ Ses pairs du systÃĻme anti-corruption ont abondÃĐ dans son sens. Le directeur gÃĐnÃĐral du Bureau IndÃĐpendant Anti-Corruption (BIANCO), Ghaby Nestor Razakamanantsoa, a pris lâexemple de leur antenne rÃĐgionale dans la rÃĐgion de Sofia. Concernant lâouverture de ce bureau rÃĐgional à Antsohihy, il a reconnu que ÂŦ nous attendons encore les moyens nÃĐcessaires. Au mieux, lâantenne n'ouvrira qu'en 2026. Âŧ
De son cÃītÃĐ, la coordinatrice des PÃīles Anti-Corruption (PAC), Rivonandrianina Rabarijohn, a enfoncÃĐ le clou, soulignant des lacunes bien au-delà du simple financement. Pour elle, un problÃĻme logistique criant persiste car le PAC ne dispose que de trois antennes sur le territoire et fonctionne avec seulement trois vÃĐhicules pour couvrir parfois jusquâà 900 km de distance lors d'audiences foraines. ÂŦ Nous sortons de notre cadre pour former des maires sur les risques juridiques. Nous demandons simplement plus de collaboration et de transparence Âŧ, a-t-elle plaidÃĐ.
ÂŦ InstitutionnalisÃĐe Âŧ
ConsÃĐquence directe de ce manque criant de moyens, la lutte contre la corruption stagne, voire recule. Sur ce sujet, les dÃĐputÃĐs prÃĐsents à lâhÃĐmicycle nâont pas eu de mots tendres envers les chefs des organismes de lutte contre la corruption, installÃĐs dans les siÃĻges visiteurs de la chambre basse. Sophie Ratsiraka, Hanitra Razafimanantsoa ou encore Siteny Randrianasoloniaiko nâont pas mÃĒchÃĐ leurs mots. ÂŦ La corruption est institutionnalisÃĐe, certains dÃĐputÃĐs ont mÊme ÃĐtÃĐ ÃĐlus grÃĒce à elle. La Haute Cour de Justice (HCJ) est inopÃĐrante. Le systÃĻme actuel protÃĻge plus quâil ne sanctionne Âŧ, a fustigÃĐ MaÃŪtre Hanitra.
MÊme tonalitÃĐ du cÃītÃĐ du septiÃĻme vice-prÃĐsident de la chambre. ÂŦ Madagascar a une note de 25/100 dans lâindice de perception de la corruption, devant la Somalie uniquement en Afrique. Sur 180 pays, nous sommes 142áĩ. Votre SAC (SystÃĻme Anti-Corruption), est-il là pour vraiment agir ou pour menacer lâopposition ? Âŧ, a-t-il lancÃĐ, suggÃĐrant de repousser la discussion à une session plus propice.
En rÃĐponse, le prÃĐsident du CSI a avancÃĐ que la troisiÃĻme StratÃĐgie Nationale de Lutte contre la Corruption (SNLCC), qui sâÃĐtend sur cinq ans, vise justement à corriger les failles des prÃĐcÃĐdentes. Il a ÃĐgalement rappelÃĐ que des obstacles juridiques, comme les immunitÃĐs et privilÃĻges parlementaires, ralentissent considÃĐrablement le processus. Mamitiana Rajaonarison, directeur gÃĐnÃĐral du SAMIFIN (Service de Renseignement Financier), a quant à lui appelÃĐ Ã la collaboration des parlementaires sur la question budgÃĐtaire. ÂŦ Il suffit de regarder la Loi de finances initiale pour comprendre lâÃĐtendue du sous-financement. Il faut nous aider Âŧ, a-t-il instamment dÃĐclarÃĐ.
Ravo Andriantsalama