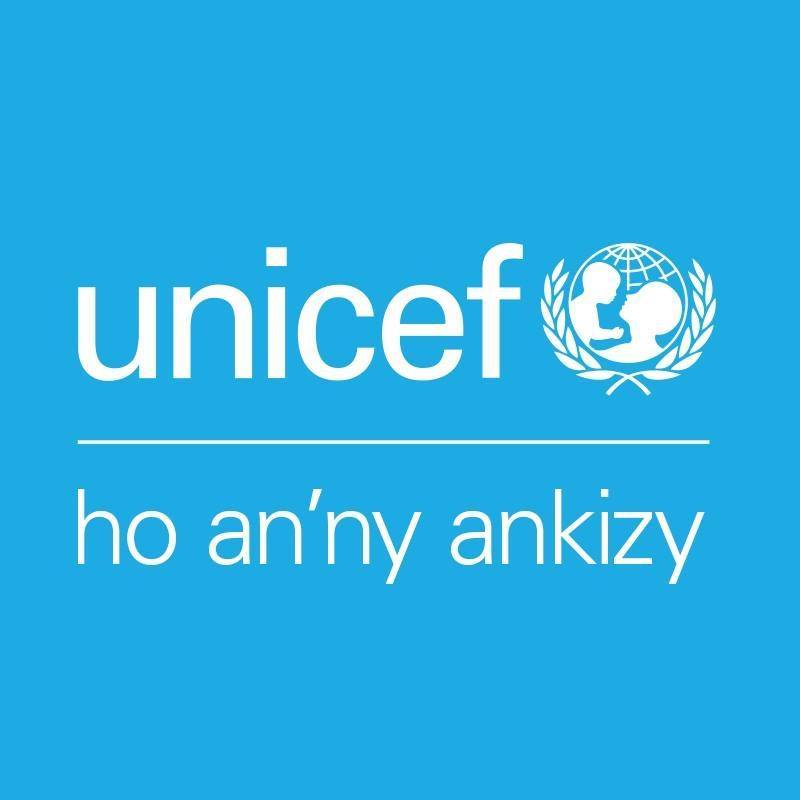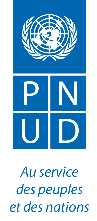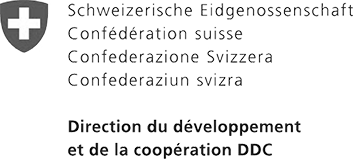La Commission Ãlectorale Nationale IndÃĐpendante (CENI) avance ses pions. Depuis Mahajanga, ArsÃĻne Dama Andrianarisedo, prÃĐsident de lâorgane ÃĐlectoral, a annoncÃĐ la proposition dâune date pour les prochaines ÃĐlections sÃĐnatoriales : le 11 dÃĐcembre 2025. Mais la balle nâest pas encore dans le camp de la CENI. Il revient maintenant au gouvernement de valider ou non ce calendrier par la publication dâun dÃĐcret de convocation des ÃĐlecteurs.
La loi organique relative aux ÃĐlections est claire, un dÃĐlai minimal de 90 jours doit sÃĐparer la convocation du scrutin. Autrement dit, si lâExÃĐcutif veut respecter lâÃĐchÃĐancier, le dÃĐcret doit Être publiÃĐ au plus tard le 11 septembre. Le temps presse. DerriÃĻre ce bras de fer institutionnel se cache une urgence politique : ÃĐviter un vide au SÃĐnat, puisque les mandats des sÃĐnateurs actuels expirent en janvier 2026.
Comme toujours dans ces sÃĐnatoriales, la population ne sera pas appelÃĐe aux urnes. Le vote est rÃĐservÃĐ aux grands ÃĐlecteurs : maires, conseillers municipaux et conseillers communaux. Douze sÃĐnateurs seront ÃĐlus, deux par province, tandis que six autres seront nommÃĐs directement par le PrÃĐsident de la RÃĐpublique. Une mÃĐcanique institutionnelle qui confirme la nature indirecte du SÃĐnat malgache, chambre haute davantage pensÃĐe comme un contrepoids politique que comme une assemblÃĐe reprÃĐsentative du suffrage universel.
Un SÃĐnat aux couleurs de lâIRMAR ?
Le paysage ÃĐlectoral laisse peu de place au suspense. LâIRMAR, coalition prÃĐsidentielle, rÃĻgne sur les communes, prÃĻs de 967 mairies sur 1 695. Les indÃĐpendants en comptent 475, tandis que le TIM et ADN se partagent quelques dizaines de siÃĻges. Dans ces conditions, le parti au pouvoir aborde ce scrutin indirect en position de force. Le SÃĐnat de demain risque fort de ressembler à celui dâhier, un instrument au service du pouvoir exÃĐcutif, plus quâune vÃĐritable chambre de rÃĐflexion.
En parallÃĻle, la CENI rÃĐunit à Mahajanga 150 reprÃĐsentants venus des six provinces pour un atelier dâÃĐvaluation. Objectif affichÃĐ : tirer les leçons des scrutins prÃĐsidentiel, communal et lÃĐgislatif, afin de renforcer la transparence et dâamÃĐliorer la crÃĐdibilitÃĐ du processus ÃĐlectoral. Mais en filigrane, les dÃĐbats soulignent surtout lâurgence dâune rÃĐforme plus large : comment construire un SÃĐnat rÃĐellement lÃĐgitime dans un pays oÃđ seuls quelques centaines de grands ÃĐlecteurs dÃĐcident de ses membres ?
La proposition du 11 dÃĐcembre ne tient pas quâà une question de calendrier. Elle ouvre un nouveau chapitre de lâÃĐquation politique malgache : entre lÃĐgalitÃĐ constitutionnelle, ÃĐquilibre institutionnel et poids ÃĐcrasant de lâIRMAR sur le terrain, ces sÃĐnatoriales pourraient bien sceller une fois de plus la mainmise du pouvoir en place sur la Chambre haute. à moins que le gouvernement ne tarde à publier son dÃĐcret, transformant ce scrutin en un test grandeur nature de sa volontÃĐ de respecter les rÃĻgles du jeu dÃĐmocratique.
Ravo Andriantsalama