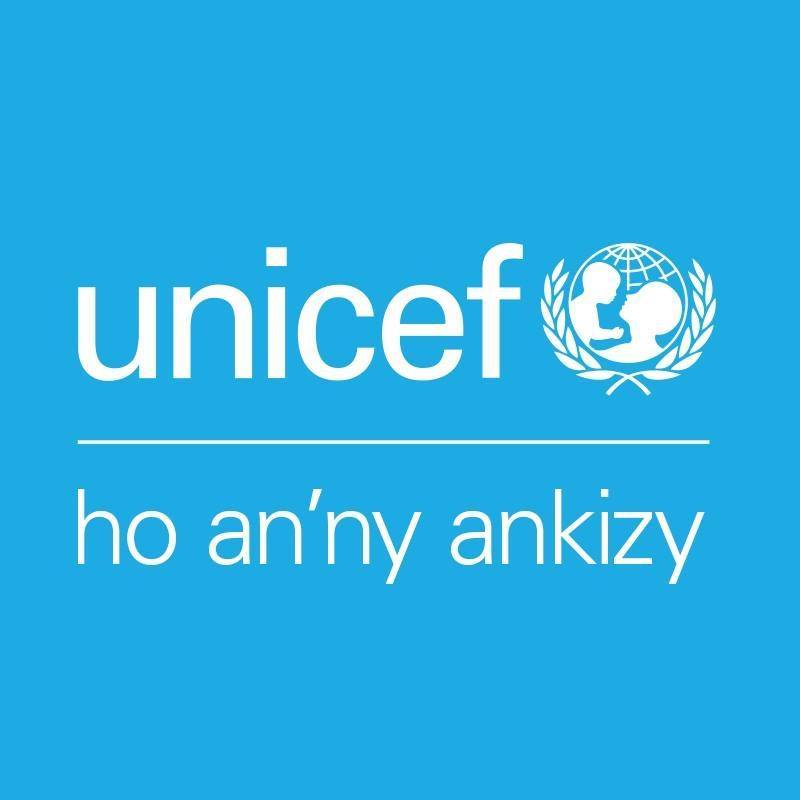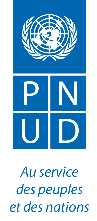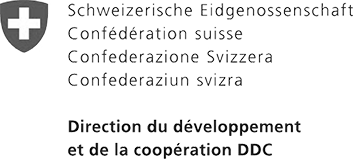La filiÃĻre des huiles essentielles à Madagascar pÃĻse entre 60 et 100 millions de dollars par an. Mais face à la rarÃĐfaction des matiÃĻres premiÃĻres, le secteur doit repenser son avenir. Pour Andrandraina Rasolonjatovo, prÃĐsident du Groupement des exportateurs, lâinvestissement dans la culture et la diversification des essences est devenu une urgence nationale.
à Madagascar, le secteur des huiles essentielles mobilise un grand nombre dâopÃĐrateurs. Rien quâau sein du Groupement des exportateurs dâhuiles essentielles de Madagascar (GEHEM), on compte dÃĐjà 70 entreprises. Chaque annÃĐe, la filiÃĻre huiles essentielles et extraits vÃĐgÃĐtaux gÃĐnÃĻre entre 60 et 100 millions de dollars de chiffre dâaffaires.
Pourtant, malgrÃĐ un marchÃĐ porteur, la concurrence internationale reste rude. ÂŦ Aujourdâhui, ce sont encore nos concurrents qui dominent les ÃĐchanges, mais Madagascar dispose de tous les atouts pour sâimposer Âŧ, estime Andrandraina Rasolonjatovo. Selon lui, la richesse des terres, la jeunesse active et surtout le statut de pays tropical offrent des perspectives uniques pour dÃĐvelopper des produits exotiques trÃĻs prisÃĐs sur le marchÃĐ mondial.
Cependant, la filiÃĻre traverse une zone dâalerte. ÂŦ La production augmente, mais les matiÃĻres premiÃĻres se rarÃĐfient Âŧ, prÃĐvient le prÃĐsident du GEHEM. En cause, la dÃĐgradation de lâenvironnement et le changement climatique. Alors quâautrefois la cueillette suffisait, il faut dÃĐsormais planter et ÃĐtendre les zones de culture pour rÃĐpondre à une demande locale et internationale en constante progression. Madagascar dispose de 36 millions dâhectares cultivables, mais seulement un tiers est actuellement exploitÃĐ. ÂŦ Il est urgent de valoriser ces terres pour les huiles essentielles en parallÃĻle de la production agricole Âŧ, insiste-t-il.
De la cueillette à la culture : un virage incontournable pour la filiÃĻre
Le cafÃĐ illustre bien cette problÃĐmatique. La plupart des plantations datent encore de lâÃĐpoque coloniale et nÃĐcessitent un renouvellement. ÂŦ Si lâon ne renforce pas la culture, la filiÃĻre sera fragilisÃĐe, car le nombre dâacteurs augmente alors que les matiÃĻres premiÃĻres diminuent Âŧ, avertit Rasolonjatovo.
MalgrÃĐ ces dÃĐfis, des signaux encourageants apparaissent. De nouvelles essences prennent leur envol à Madagascar, comme le patchouli, dont la production explose dans le nord de lâÃŪle. TrÃĻs demandÃĐ Ã lâinternational, ce marchÃĐ traditionnellement dominÃĐ par lâIndonÃĐsie offre une opportunitÃĐ majeure. Le vÃĐtiver, autre produit phare, connaÃŪt ÃĐgalement une forte progression à lâexportation. ÂŦ Haiti a longtemps occupÃĐ la premiÃĻre place, mais ses crises politiques ont ouvert une brÃĻche. Madagascar sâimpose dÃĐsormais comme un concurrent direct Âŧ, explique le prÃĐsident du GEHEM.
Le gÃĐranium est ÃĐgalement en plein essor, tandis que le ravintsara, qui avait explosÃĐ durant la pandÃĐmie de Covid-19, voit sa demande ralentir. ÂŦ Cela prouve quâil est indispensable de rÃĐaliser en permanence des ÃĐtudes de marchÃĐ pour anticiper les tendances Âŧ, souligne Rasolonjatovo.
Pour lui, lâavenir de la filiÃĻre repose sur deux leviers : ÃĐlargir les surfaces cultivÃĐes et diversifier les essences. ÂŦ Les huiles essentielles peuvent devenir un moteur du dÃĐveloppement ÃĐconomique du pays si nous investissons dans la culture et la valorisation durable de nos ressources. Âŧ
Ravo Andriantsalama