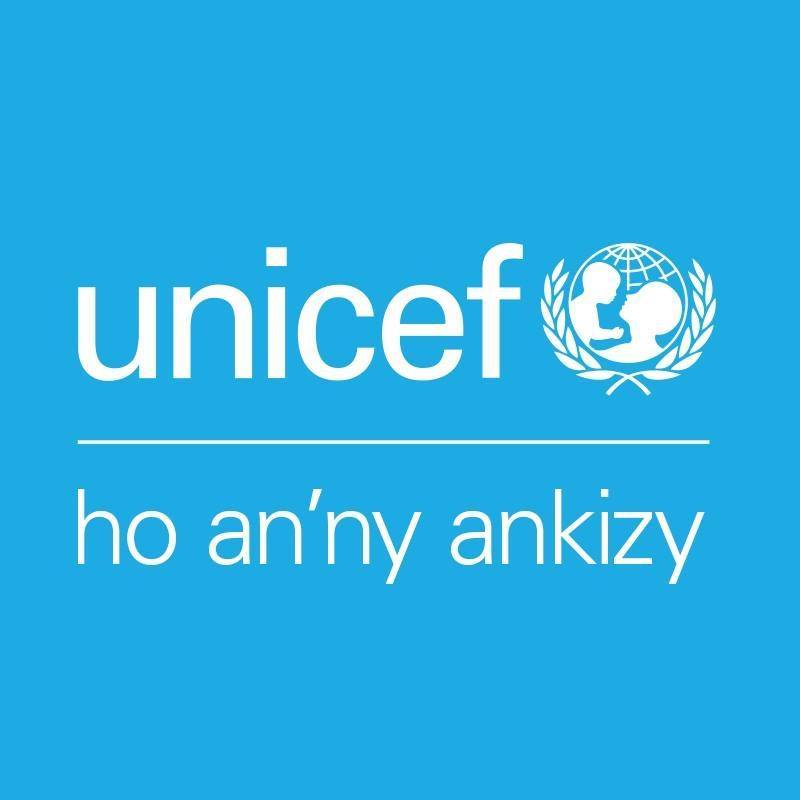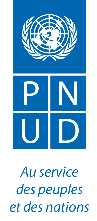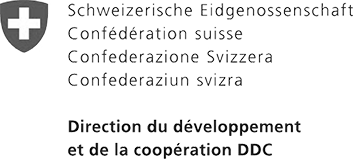Ce matin, à son esplanade à Ankatso, lâuniversitÃĐ dâAntananarivo a accueilli la naissance dâun nouvel acteur du dÃĐbat sanitaire : le Centre dâÃĐtude et de recherche en ÃĐconomie de la santÃĐ (CERES). à sa tÊte, le Professeur Blanche Nirina Richard, ÃĐconomiste chevronnÃĐe, qui revendique un credo simple : ÂŦ Nous dÃĐveloppons la recherche par la recherche Âŧ.
Former pour ÃĐclairer les dÃĐcisions
Pour Blanche Nirina Richard, lâÃĐconomie de la santÃĐ nâest pas une discipline abstraite. Câest un outil, parfois dÃĐcisif, pour aider les autoritÃĐs à choisir entre plusieurs politiques sanitaires et à hiÃĐrarchiser les projets. ÂŦ Nous formons, nous encadrons, nous ÃĐvaluons Âŧ, explique-t-elle. ÂŦ Lâobjectif est de donner aux dÃĐcideurs les moyens de minimiser les coÃŧts tout en atteignant les objectifs de santÃĐ publique avec les ressources disponibles, quâelles soient financiÃĻres, techniques ou humaines Âŧ, poursuit-elle.
Le CERES, rattachÃĐ Ã la mention ÃĐconomie de la facultÃĐ EGS, veut Être ce lieu oÃđ la recherche acadÃĐmique se met au service des rÃĐalitÃĐs du pays. Des partenariats existent dÃĐjà , tant avec les universitÃĐs malgaches quâavec des institutions internationales, ainsi quâavec les organes liÃĐs au ministÃĻre de la SantÃĐ publique, comme lâInstitut national de santÃĐ publique et communautaire (INSPC).
Le champ dâexploration est vaste. Les chercheurs du CERES travaillent sur les grandes ÃĐpidÃĐmies tels le VIH/Sida, la tuberculose, le paludisme, la peste, ou encore le Covid-19, mais aussi sur la gestion des structures sanitaires, des hÃīpitaux aux Centres de santÃĐ de base (CSB). LâaccÃĻs aux soins occupe une place centrale : comment se soigner lorsque lâon nâa pas les moyens financiers ? Quels sont les obstacles qui empÊchent les patients de recourir au systÃĻme formel ? Souvent, rÃĐpond le Pr. Nirina, ce sont des problÃĻmes de gestion, un manque de personnel ou lâabsence de responsables qui paralysent la machine.
Entre science et dÃĐcisions politiques
Autre objet dâÃĐtude : la mÃĐdecine traditionnelle. DÃĐsormais reconnue officiellement par le ministÃĻre, elle mÃĐrite, selon le CERES, une place spÃĐcifique dans lâorganisation sanitaire nationale. ÂŦ Nous analysons la maniÃĻre dont cette mÃĐdecine, dÃĐjà largement pratiquÃĐe, peut coexister avec la mÃĐdecine moderne dans un cadre mieux dÃĐfini Âŧ, souligne la professeure.
Reste une question cruciale : lâÃtat se saisira-t-il de ces travaux pour corriger les inÃĐgalitÃĐs dâaccÃĻs aux soins ? Le Pr. Blanche Nirina Richard rÃĐpond avec prudence. Selon elle, ÂŦ les ÃĐconomistes proposent toujours des projets, mais ce sont les dÃĐcideurs qui tranchent. Or leurs prioritÃĐs ne coÃŊncident pas toujours avec nos recommandations. La mise en Åuvre dâune politique ne dÃĐpend pas uniquement des arguments ÃĐconomiques. Âŧ
Pour renforcer lâimpact de la recherche, le CERES et le ministÃĻre de la SantÃĐ prÃĐvoient la crÃĐation dâune ÃĐquipe dâÃĐconomistes de la santÃĐ et le lancement prochain dâun master spÃĐcialisÃĐ Ã lâuniversitÃĐ dâAntananarivo. Lâobjectif est de former une nouvelle gÃĐnÃĐration de chercheurs capables de traduire les donnÃĐes scientifiques en politiques publiques.
Entre pragmatisme et ambition, le Pr. Blanche Richard Nirina trace ainsi une voie : faire de lâÃĐconomie de la santÃĐ un outil au service de lâÃĐquitÃĐ sanitaire. Une discipline qui, à Madagascar, sort enfin de la confidentialitÃĐ pour devenir un levier stratÃĐgique.
Ravo Andriantsalama